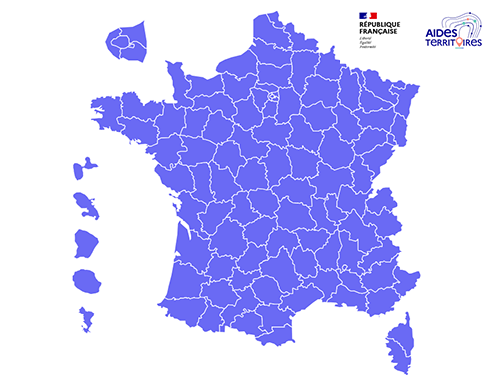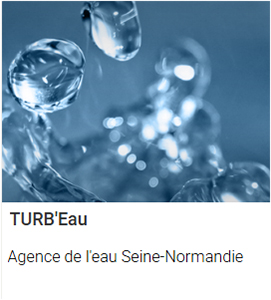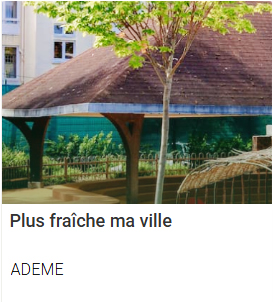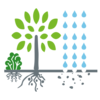
Solutions vertes
Fondées sur la nature, elles privilégient le recours au végétal, aux écosystèmes et aux processus naturels pour diminuer la sensibilité et augmenter la capacité adaptative des systèmes humains et naturels au changement climatique. Ces solutions sont fortement encouragées, puisqu’il s’agit généralement d’actions sans regret (par exemple, désimperméabilisation et végétalisation d'un parking).
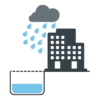
Solutions grises
Ce sont des solutions dites d’ingénierie traditionnelle, relatives aux infrastructures, et s’appuient sur des dispositifs techniques (forme urbaine, mobilier urbain, revêtement, dispositifs liés aux bâtiments…). Il s’agit par exemple d’une cuve enterrée de récupération des eaux pluviales, de digues…
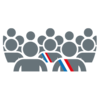
Solutions douces
Elles renvoient aux réponses institutionnelles, organisationnelles, financières et politiques. Elles peuvent reposer sur la modification des modalités de gestion et d’organisation d’une institution (modification des horaires de travail, structuration d’un collectif de travail spécifique…), l’évolution des normes ou documents de planification, ou même reposer sur les citoyens (pratiques encouragées comme l’aération nocturne).