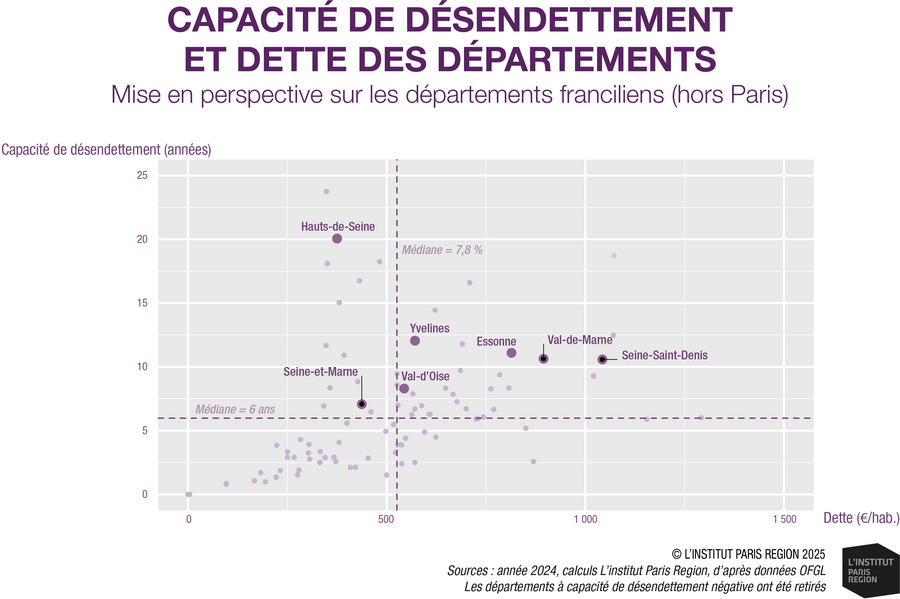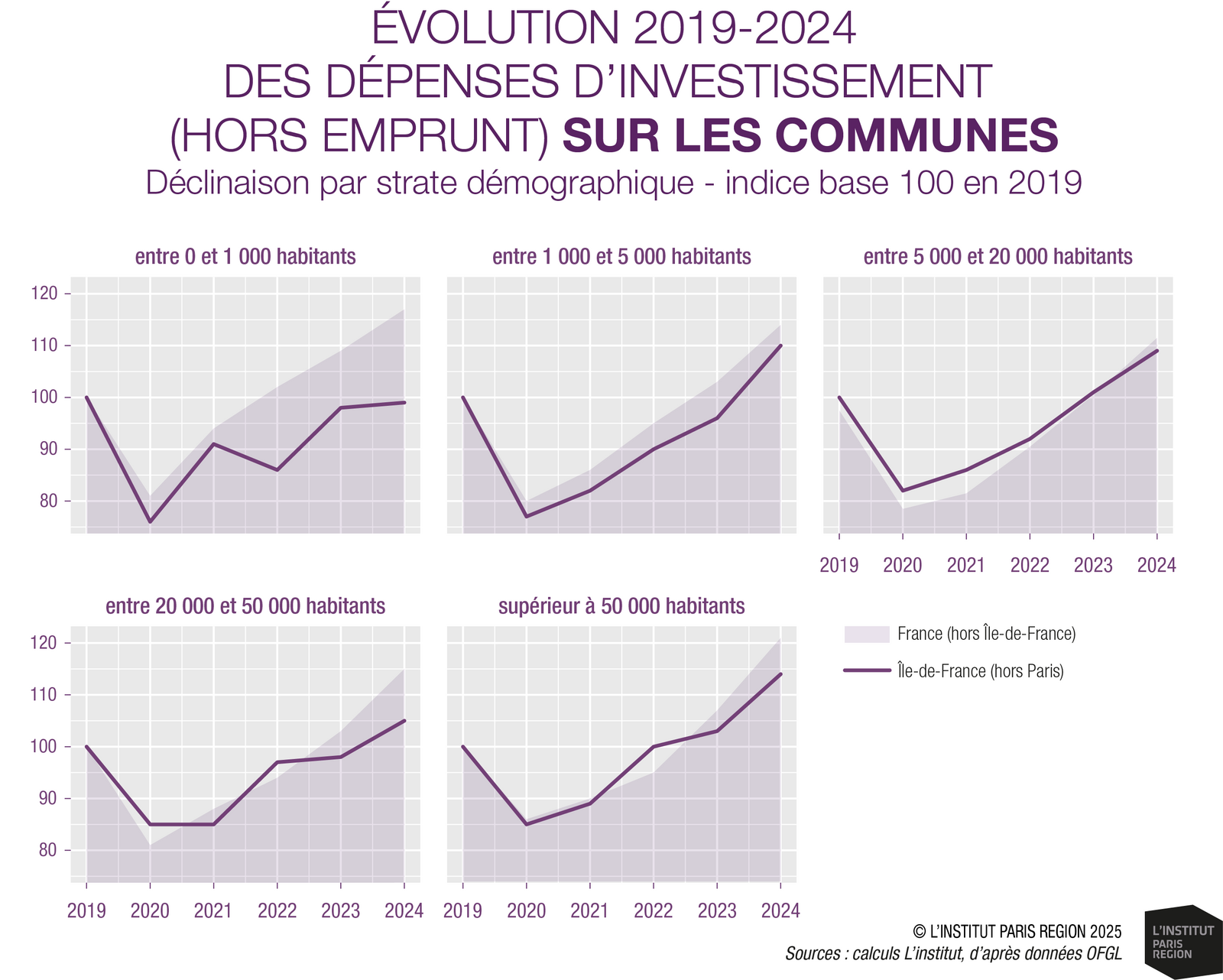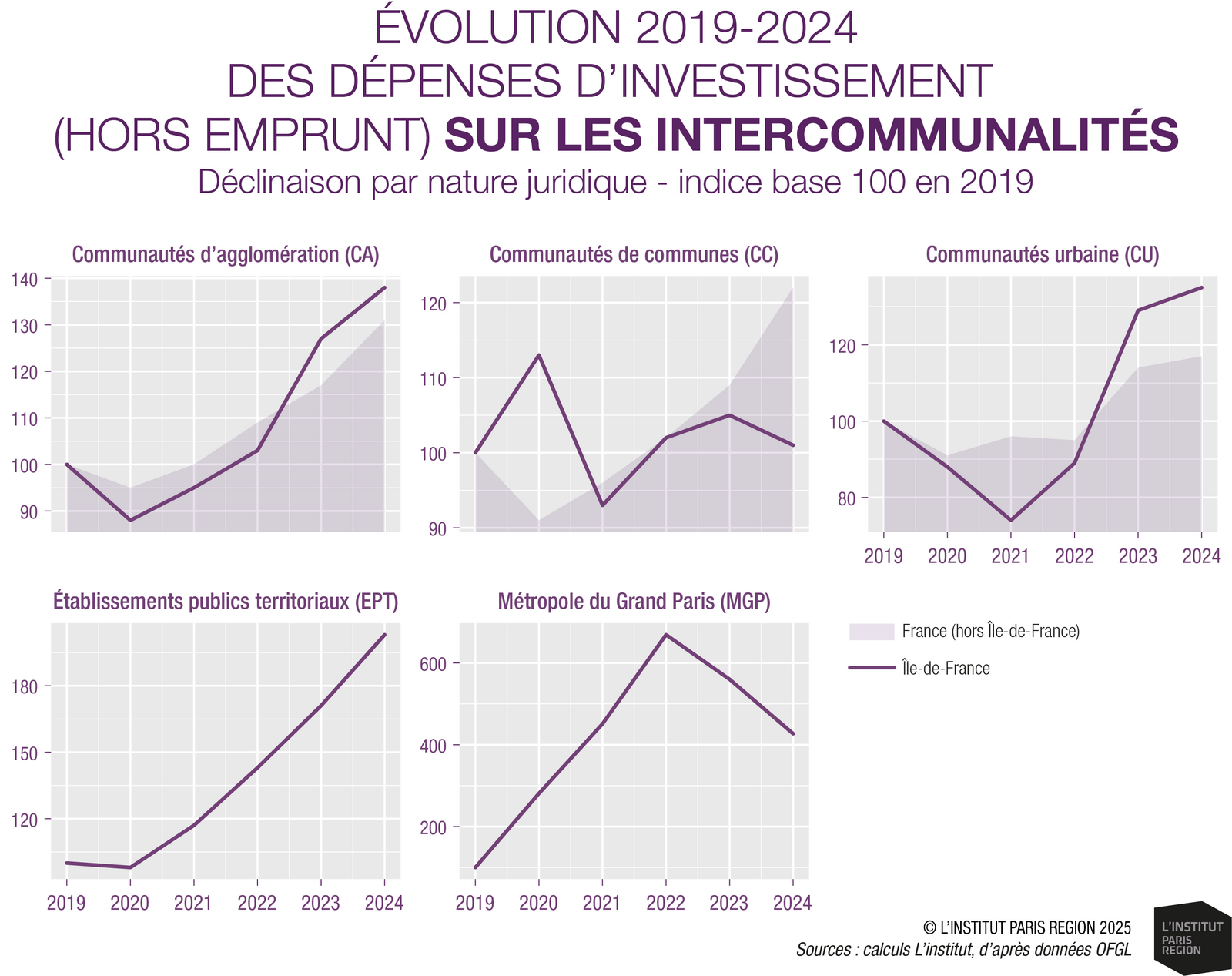Les communes hors Paris
Au niveau des recettes, tout d’abord, le bloc communal dispose de ressources locales encore dynamiques (taxes assises sur le foncier, cotisation foncière des entreprises) sur lesquelles les structures disposent d’un pouvoir de taux. En 2024, près de 230 communes avaient ainsi augmenté celui de la taxe foncière sur les propriétés bâties, leur principale recette de fonctionnement. L’échelon communal (hors Paris) est le seul dont les recettes de fonctionnement ont progressé plus rapidement que leurs dépenses (3,7 % contre 3,3 %). Cette croissance provient également d’une hausse inédite de leurs recettes tarifaires dont le produit total a progressé de plus de 10 % entre 2023 et 2024. Cette progression semble provenir d’une contribution accrue des usagers aux activités périscolaires, culturelles et sportives et, dans une moindre mesure, à une hausse des recettes ayant trait au stationnement (ex : forfait post stationnement).