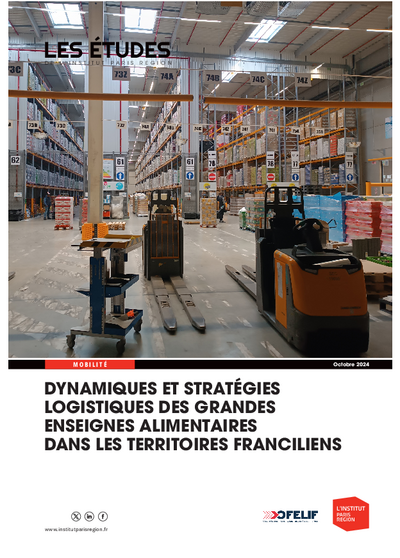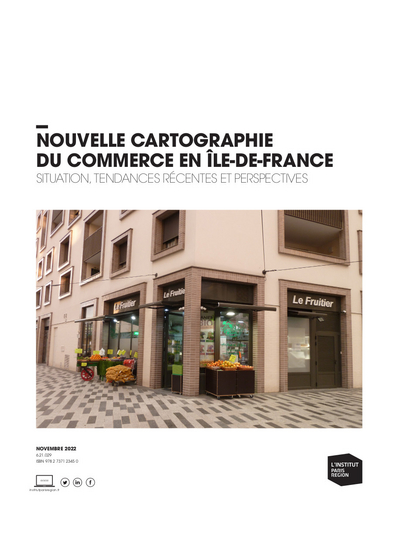Dynamiques et stratégies logistiques des grandes enseignes alimentaires dans les territoires franciliens
Dans le cadre de l’Observatoire du fret et de la logistique en Île-de-France (OFELIF), la présente étude cherche à détailler le fonctionnement territorial des circuits de la grande distribution régionale. Elle s’appuie sur un travail de traitement systématique du secteur grâce à la base de données TradeDimensions de Nielsen, complétée par des entretiens semi-directifs avec des professionnels du secteur. Cette double approche permet d’appréhender quantitativement et qualitativement l'organisation des relations entre les points de vente et des espaces amont de stockage qui les approvisionnent.
Les divers éléments mobilisés permettent de dresser une carte de l’organisation logistique de la grande distribution alimentaire en Île-de-France et d’apporter des éléments de réponse à diverses interrogations :
- L'organisation logistique diffère-t-elle selon le canal considéré (vente en magasin, drive) ? Selon la nature de la marchandise (alimentaire, frais, sec) ? Selon le distributeur et son segment de marché ?
- Quelle est la taille et la localisation des plateformes logistiques suivant les magasins desservis et leur spécialisations (produits frais, surgelés, secs, non-alimentaire etc.) ? Les variations entre groupes sont-elles structurantes pour l’activité ?
- Comment s’organisent géographiquement les différentes chaînes logistiques des distributeurs GSA (Grandes Surfaces Alimentaires) ? En quoi cette organisation diffère-t-elle du reste de l’activité logistique francilienne ?
- Dans quelle proportion les plateformes actives en Ile-de-France ont-elles un rayonnement local, régional ou national ? Comment se structurent leurs aires de chalandise ?
- Quelle est la distance moyenne parcourue entre une base logistique et un point de vente francilien ? Dans quelle mesure, cette donnée varient-elle selon la taille du magasin, celle de la plateforme, la densité, ou le type de réseau de distribution ?
- Selon quels découpages logistiques s'organisent les territoires ? Y a-t-il par exemple une structuration logistique infrarégionale pour la grande distribution ou au contraire une plateforme est-elle appelée à rayonner sur l’ensemble de l'Ile-de-France ? Les modèles à l’œuvre sont-ils concordants entre les enseignes ?
- Comment l’organisation logistique du secteur a-t-elle évolué au cours de la dernière décennie et quels facteurs sont-ils susceptibles d’en expliquer les dynamiques ?
Les principaux résultats de l’étude mettent en avant quelques points saillants concernant les données factuelles et permettant de rendre compte des dynamiques organisationnelles.
Les plateformes de distribution dédiées à la grande distribution alimentaire en Île-de-France comptent actuellement 54 sites, couvrant une surface totale d’un peu moins de 2 millions de m²), soit 14 % de la surface logistique bâtie en Île-de-France (données IPR 2023), avec une surface moyenne de 37 000 m² par site. Chaque base logistique approvisionne en moyenne 40 points de vente, contre 32 points en 2013, souligant la densification du réseau commercial francilien. L’évolution des implantations des bases logistiques semble indiquer que l’étalement logistique longtemps à l’œuvre n’est plus vérifée en Île-de-France, au moins pour le secteur des grandes surfaces alimentaires (GSA).
Le maillage des points de vente évolue vers une densification de l’offre (+50 % de points de vente entre 2013 et 2023), au profit du format supermarché de zone dense ; le modèle de l’hypermarché de périphérie ne fait plus recette. On observe une convergence vers des modèles de distribution plus adaptés aux besoins actuels du marché, tels que l'accent mis sur les formats de supermarchés dans les zones denses plutôt que sur les hypermarchés en périphérie. Cette transition reflète une réponse collective aux changements de comportement des consommateurs et à la demande croissante de proximité associée au recours au commerce en ligne pour les achats non-alimentaires, qui percutent le modèle même de l’hypermarché et du « tout sous un seul toit ».
Les groupes continuent à offrir un large éventail de profils allant d’Intermarché où domine le format hyper et Casino qui se réorganise sur les magasins urbains de petite taille, voire le micro-retail. Cette évolution induit une réorganisation des schémas logistiques existant avec l’intensification des flux et l’accroissement sensible de la taille des bases logistiques qui renforcent leur forte concentration au sud de l’Île-de-France où l’A104 se substitue progressivement à l’A86. Ce choix combine l’opportunisme foncier du sud Seine-et-Marne (plus que du choix des acteurs de la GSA) à un bon compromis d’accessibilité régionale et nationale. La saturation des infrastructures routières reste néanmoins un élément de forte contrainte dans les plans de transport et les alternatives modales (type Franprix/XPO) ne sont guère développées.
La grande distribution alimentaire francilienne s’avère fortement intégrée à une organisation nationale et macrorégionale, les contours administratifs de l’Île-de-France n’ont que peu de portée. Le bassin de consommation francilien est de fait marqué par sa forte densité, mais ses caractéristiques organisationnelles ne le singularisent pas par rapport aux autres métropoles françaises, sinon par son extension géographique. La logistique associée se structure préférentiellement en deux pôles, avec un sud plus puissant et un nord qui couvre volontiers les territoires adjacents, picards et hauts-normands. Sa centralité géographique est aujourd’hui contrebalancée par l’Orléanais.
La décennie 2013 - 2023 marque un cycle important de réorganisation avec la restructuration de bâtiments logistiques, la modernisation/reconstruction pour les acteurs historiques et la montée en puissance pour les nouveaux entrants (réseaux à dominante marques propres). Dans cette dynamique, les plateformes dédiées aux drives ne jouent qu’un rôle secondaire. S’impose surtout le modèle de la base multiproduits – multiformats, l’internalisation des opérations sur un seul site, avec pour conséquence des surfaces moyennes qui doublent pour atteindre les 40 000 m2 (et jusqu’à 60 000 m2). Les schémas d’implantation divergent toutefois fortement selon les enseignes, de même, le rayonnement des plateformes oppose celles qui ont une couverture nationale (non-alimentaire, produits secs), souvent localisées hors Île-de-France, à celle dont la portée est plus régionale (produits frais, produits à rotation rapide), avec une déclinaison de formes intermédiaires, notamment pour les produits surgelés distribués selon une logique multirégionale (4 à 5 points de stockage en France).
Cette étude est reliée aux catégories suivantes :
Économie |
Commerce et consommation |
Territoires économiques |
Mobilité et transports |
Transport de marchandises et logistique